Les sites d'émetteurs
Les émetteurs sont de différentes puissances ; ils peuvent varier de 1000 à 100000 watts selon la licence accordée par le CRTC pour la couverture du territoire établi. La plupart des émetteurs fonctionnent avec des tubes à hauts voltages. Les tubes employés pour ces appareils sont des Triodes, Tétrodes, et Pentodes. Leurs bases sont en verre ou en céramique. Ils sont souvent refroidis à l'air forcé, à la vapeur ou à l'eau. Avec la nouvelle technologie transistorisée, les lampes sont moins nécessaires car ils fonctionnent avec des voltages plus bas mais avec des courants plus élevés. Une excellente ventilation au bâtiment est nécessaire pour évacuer la chaleur intense provoquée par les émetteurs de haute puissance. Ces sites sont souvent situés dans des zones isolées tel que les montagnes et boisés. Il est donc fréquent d'y faire des rencontres avec les animaux sauvages de la région. Au Mont Valin du Saguenay et au Mont Bélair de Québec, il n'est pas rare d'y apercevoir des ours et des orignaux. Les bâtiments sont des endroits propices à l'infiltration de bestioles tel que des insectes, des souris et des couleuvres. L'accessibilité se fait par les entrées et sorties de ventilation ainsi que par les tuyaux et les orifices pour câblages. Souvent, l'accessibilité des sites est assujettie aux conditions de la température. Les chemins brisés par les pluies et la neige en abondance nous oblige à utiliser des motoneiges. Le verglas, quant à lui, est l'ennemi juré des sites d'émetteurs causant la perte d'électricité et endommageant parfois les câblages et les antennes. La crise du verglas vécue en 1998 a détruit plusieurs antennes AM et FM.
|
|
Informations Technique |
Qu'est ce que la radiodiffusion et comment ça fonctionne |
La radio est un moyens de communication bien connu de nos jours. Cependant il ne faut pas croire que la découverte de la radio telle qu’elle est employée de nos jours est le fruit du travail d’un seul homme.
Vers 1820, Jean-Christian Oersted, physicien et chimiste danois, découvrait qu’un courrant électrique engendre du magnétisme. Cette découverte attire l’attention du jeune savant anglais Michael Faraday, physicien et chimiste anglais qui découvre le principe de l’induction électromagnétique. À l’aide de ces deux grandes découvertes, James Maxwell, un physicien et mathématicien écossais prouvait que la lumière est une série d’ondes qui se déplacent dans l’espace. Entre temps, l’Américain Samuel Morse, un peintre américain, construisait un appareil capable de transmettre des sons à distance par l’entremise de fils : le télégraphe était né. Son fonctionnement est simple : des pulsations de courant envoyées sur une ligne produisent momentanément du magnétisme dans une bobine reliée par fil et située à l’autre bout de la ligne. Ce magnétisme attire une tige de fer doux et produit des sons plus ou moins longs suivant la durée des pulsations, par l’entremise d’un code, les sons sont traduits en lettres et en mots. En 1875, Alexander Graham Bell, inventait le téléphone qui permettait de transmettre la voix humaine à des milliers de kilomètres de distance. En 1888, Édouard Branly physicien et chimiste français réussissait dans son laboratoire de Paris à établir les premières radiocommunications ; un nouveau pas de géant était fait, la télégraphie sans fil était née. En 1899 Guglielmo Marconi, un physicien italien utilisant la découverte de Branly, réussissait à envoyer un radiotélégramme de Douvres à Boulogne réalisant ainsi la première radiocommunication à longue distance. Il restait à présent à transmettre la voix humaine et la musique par radio. En 1912 c’est avec l’invention des lampes à incandescence d’Edison et des lampes diode ou à 3 électrodes de Fleming qu’on réussit à transmettre des sons intelligibles. En 1920, les premiers programmes radiophoniques étaient diffusés à Pittsburgh.
La nature du son
La musique que nous écoutons à partir de notre appareil récepteur de radio nous parvient sous forme d’ondes radiophoniques.
Le son produit par la voix, un haut-parleur de radio ou par un bruit quelconque est le résultat d’un mouvement vibratoire qui, transmis par l’air, parvient à nos oreilles sous forme d’ondes. Pour reproduire un mouvement vibratoire, fixons dans un bloc de bois une petite lame d’acier comme à la figure 1. Amenons la lame au point C, puis relâchons-là en la laissant vibrer librement. L’extrémité de la lame passe par le point B, qui marque sa position initiale, continue jusqu’au point A, revient au point B et recommence le même mouvement pour s’arrêter enfin en B, son point de départ, son point d’équilibre. Chaque fois que l’extrémité de la lame partie de B est revenue à B en passant dans l’ordre par les points A, B, et C, le mouvement complet prend le nom de cycle. |
|
Les antennes
Les antennes AM sont généralement installées dans des champs marécageux qui facilite ainsi le système de mise à la terre (grounds). La structure de la tour elle-même isolée de la mise à terre est l'émettrice. L'antenne FM, contrairement à cette dernière, est installée dans la structure de la tour et c'est cette installation qui constitue la mise à la terre tout comme les antennes de télécommunication (micro-onde 950.000 MHz, UHF, télévision et cellulaire). Au centre-ville, on privilégie les tours auto-portantes à cause des superficies des terrains, de la hauteur peu élevée (300 pieds) et des coûts plus abordables. En région, ce sont les tours avec haubans qui sont souvent utilisées. Ces tours peuvent varier en hauteur de 500 à 1500 pieds et sont munis de balises rouges ou stroboscopiques pour situer leur emplacement pour le trafic aérien. C'est dans ces structures que l'on installe divers types d'antennes. Plusieurs formats d'antenne sont conçues pour transmettre soit omnidirectionnel (circulaire), directionnel (vertical ou horizontal) (antenne à panneau). L'exposition de ces appareils en altitude et au climat du Québec oblige une organisation additionnelle. Pour contrer les problèmes dus au gel et au verglas, plusieurs antennes sont munies de fils chauffant à l'intérieur de l'antenne et d'autres sont munis de radômes pour protéger l'antenne elle-même. Les antennes sont reliées par un câblage coaxial qui descend jusqu'à la base de la tour et se rend au bâtiment qui contient les émetteurs. La structure est partagée par plusieurs locataires afin de rentabiliser le site d'émetteur. Les radiodiffuseurs, le gouvernement du Québec, la sûreté du Québec, les Travaux publiques, les compagnies de téléphonie cellulaire et Internet sont les principaux occupant de ces pylônes. |
|
L'onde sonore |
Si nous schématisons le mouvement décrit par l’extrémité de la lame, nous obtenons l’oscillogramme des ondes, c’est-à-dire un dessin qui représente le mouvement des ondes. L’abscisse (ligne horizontale xx) exprime la durée de la vibration tandis que l’ordonnée (ligne verticale yy) indique l’amplitude de la vibration. Ces deux lignes sont appelées les coordonnées graphiques. |
(fig. 1) |
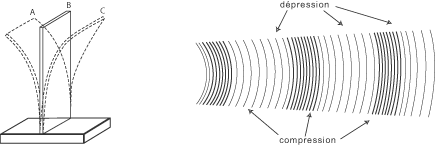 |
L'amplitude et la fréquence |
| L’amplitude représente la hauteur sur le graphique de la figure 2. Plus l’amplitude d’une onde est élevée, plus le mouvement décrit par l’extrémité de la lame est ample.
C’est la fréquence d’une onde qui détermine sa perception auditive; l’oreille humaine perçoit les sons dont la fréquence est comprise entre 20 et 20 000 cycles. En bas de 20 cycles, l’oreille perçoit des pulsations mais elle ne peut les identifier en tant que sons au sens musical du terme. Il est rare que l’on rencontre des être humains dont le sens de l’ouie soit assez développé pour percevoir des sons hors de ces limites. Les ondes auxquelles nos oreilles sont sensibles se nomment ondes sonores. |
(fig. 2) |
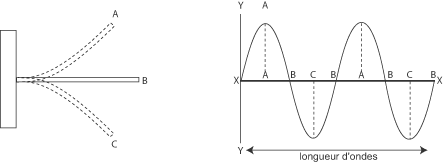 |
Émission et réception |
Les ondes radiophoniques sont complètement différentes des ondes sonores; ces dernières résultent d’un mouvement vibratoire qui met les molécules d’air en mouvement, tandis que les ondes de radio sont des vibrations électriques et magnétiques. La fréquence des ondes de radio est beaucoup plus élevée que celle des ondes sonores; les ondes de plus de 20 000 cycles de fréquence se nomment ondes radiophoniques.
La figure 3 schématise les opérations successives de l’émission à la réception des ondes de radio.
En général, un système de radio comprend un appareil émetteur et un appareil récepteur. |
(fig. 3) |
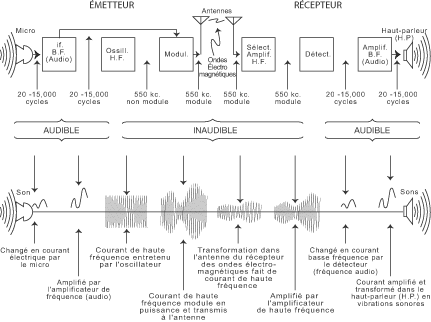 |
À la figure 3 on trouve un diagramme de l’émetteur et du récepteur de radio, chaque section étant représentée par un rectangle.
L’appareil qui amplifie les pulsations électriques du microphone et qui, par l’intermédiaire d’un oscillateur, d’un modulateur et d’une antenne permet à ces courants électromagnétiques de franchir de grandes distances, s’appelle l’émetteur. L’équipement complet nécessaire à l’émission d’ondes radiophoniques est installé dans un poste émetteur ou encore dans une station émettrice de radio. L’appareil récepteur est celui qui reçoit les ondes de radio, puis les change en pulsations électriques et finalement en ondes sonores.
Il contient habituellement :
|
|
Une antenne qui capte les ondes de radio (ondes porteuses modulées) ; |
|
|
Un amplificateur car les ondes ont perdu de leur intensité entre l’appareil émetteur et l’appareil récepteur ; |
|
|
Un détecteur que rejette les ondes porteuses tout en gardant les pulsations électriques ; |
|
|
Un amplificateur audio qui amplifie les courants électriques ; |
|
|
Un haut-parleur qui restitue les ondes sonores émises (sons, musique, voix…). |
Les rectangles utilisés à la figure 3 représentent les différentes sections d’un système de radio, et facilitent ainsi la compréhension du principe général de l’émission et de la réception des ondes. Cependant, chaque section d’un émetteur ou d’un récepteur, est composée de résistances, de bobines, de lampes ou de transistors et de condensateurs reliés entre eux pour contrôler et modifier le mouvement des électrons dans ces appareils électriques afin de rendre possible la réception des ondes. Pour bien comprendre le fonctionnement d’un émetteur ou d’un récepteur de radio, il est nécessaire de connaître parfaitement l’électricité et les circuits électriques parce que l’âme de la transmission et de la réception c’est l’électron. |
|



